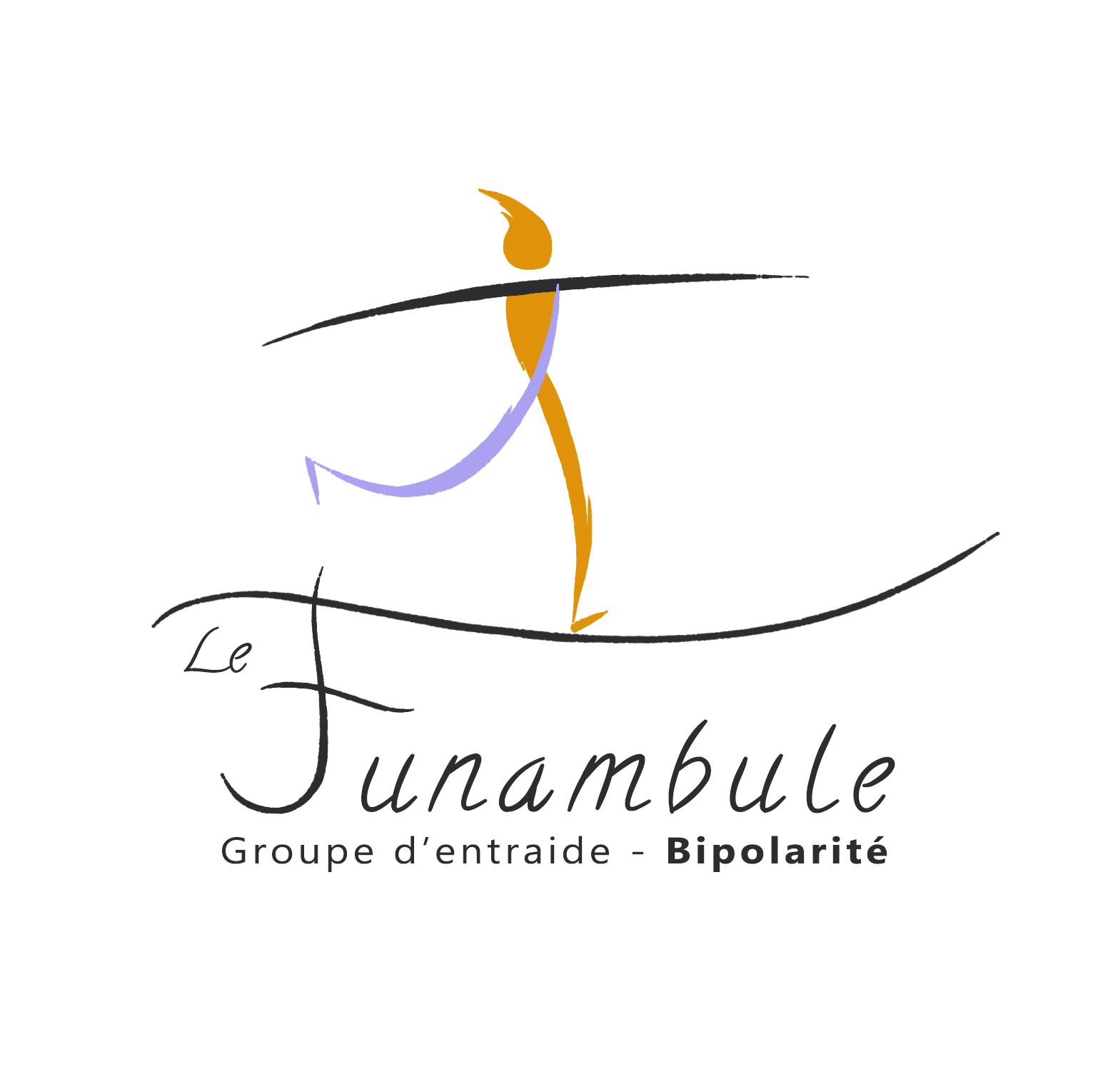Le texte ci-dessous est la transcription d’une conférence donnée en 2014 par Hélène Gabert et Marie Alvéry au GRAP en Suisse sur le thème de la vie affective, couple, sexualité… lorsqu’on est atteint d’un trouble bipolaire.
Présentation
Hélène Gabert : Agée de 42 ans, mariée, avec deux enfants, je vis à Bruxelles. J’ai fait de ma passion, à savoir le coaching sportif, mon activité professionnelle. Je suis également administratrice de l’association bruxelloise d’entraide, le Funambule*, créée par et pour les personnes atteintes de troubles bipolaires.
Marie Alvéry : J’habite actuellement à Paris où je travaille comme éditrice. J’ai vécu huit ans à Bruxelles, où j’ai rencontré Hélène. Je suis également mariée et ai des enfants. Je suis atteinte d’un trouble bipolaire de type I. Ce dernier se caractérise par une alternance de phases maniaques et de phases dépressives sévères, avec des intervalles libres. En épisode maniaque, la personne manifeste une exaltation exacerbée, qui peut l’amener à perdre pied avec la réalité et donner lieu à des crises de délires et de paranoïa. Cette phase dure en général quelques jours et est systématiquement suivie d’une période de profonde dépression, pouvant aller de plusieurs semaines à plusieurs mois.
Hélène Gabert : Je souffre pour ma part d’un trouble bipolaire de type II, diagnostiqué lorsque j’avais 32 ans. Si l’on compare ce trouble avec celui de Marie (type I), les phases maniaques sont moins fortes, raison pour laquelle on les qualifie d’hypomaniaques. Celles-ci durent aussi plus longtemps. Elles sont également suivies de périodes dépressives intenses. À relever que 4 à 5 % de la population souffre de troubles bipolaires.
C’est par hasard, lors d’un vernissage à Bruxelles, que Marie et moi nous sommes rencontrées. À l’époque, l’affaire Strauss-Kahn battait son plein. Comme tout le monde, nous en avons discuté. Ayant moi-même été en proie à des pulsions, je me souviens avoir dit que je pouvais comprendre ses dérapages, tout en précisant que je n’excusais ni cautionnais ses actes. Marie m’a regardé avec de grands yeux… Au fil de la discussion, Marie m’a parlé de son expérience de la bipolarité et je lui ai raconté la mienne. Nous ne sommes pas vraiment retrouvés dans le vécu l’une de l’autre, puisque nos troubles respectifs étaient différents. Bref, le contact était noué et s’est poursuivi.
En lien avec mon travail pour l’association Funambule, j’avais le projet de publier un recueil de témoignages de personnes atteintes de troubles bipolaires. Je me suis bien évidemment permis de demander conseil à Marie, qui était éditrice. Elle m’a offert son aide et ensemble nous avons travaillé sur un synopsis. Il en est sorti un récit** écrit à quatre mains, dans lequel nous avons raconté notre vécu.
Vie affective
Hélène Gabert : Je viens d’une famille unie, aimante, très catholique pratiquante et qui n’avait pas été épargnée par la guerre. Même si les membres de ma famille étaient très peu démonstratifs dans leurs sentiments, cela ne m’a pas empêchée d’être une petite fille joyeuse, souriante et très sociable, avec un besoin par contre très fort de contact. Mais, au fil du temps, ce besoin s’est teinté d’une forme de nostalgie, qui trahissait un manque affectif grandissant. J’avais de plus en plus le sentiment d’être mal aimée par ma famille, par mes parents.
Très jeune, j’ai commencé à cultiver de grands idéaux de relation qui répondait à cette carence affective. Très fleur bleue, je m’amourachais du premier beau jeune homme venu. C’est avec impatience que j’attendais l’arrivée du prince charmant qui m’apporterait enfin toute l’affection dont je manquais. Cependant, j’ai très vite déchanté. Lors de ma première relation sérieuse, le garçon m’a dit: «Si tu m’aimes, fais-le!» C’est ainsi, de manière très froide, que je suis entrée dans la sexualité… On me proposait quelque chose qui, pour moi, ne correspondait pas du tout à mes attentes. Cela m’a rappelé quelques abus et attouchements dont j’avais été victime petite, par la générosité de mes parents qui accueillait un enfant orphelin pendant les vacances. Cette entrée dans la vie sexuelle n’a donc pas été très heureuse et tous mes sentiments se sont effondrés.
Marie Alvéry : j’ai moi aussi ressenti un manque affectif très fort, en particulier durant mon enfance. Issue d’une famille normale, plutôt aisée avec trois frères et sœurs, j’ai pâti d’une mère totalement désengagée de son rôle. Grosso modo, il ne fallait pas l’embêter. À trois mois, j’ai été hospitalisée pendant trois-quatre semaines à cause d’une coqueluche. À aucun moment, mes parents ne sont venus me voir. De nos jours, on sait que cela ne fait pas du bien à l’enfant. À l’époque, il aurait certes fallu faire preuve d’un peu plus d’imagination… C’est à partir de cette expérience que s’est développé en moi un très fort sentiment d’abandon, que je parviendrais à identifier au cours d’une psychanalyse et que je retrouverais lors de crises maniaques.
J’ai donc eu une enfance triste et assez malheureuse, bien que confortablement installée. Je portais en moi quelque chose de sombre, même si par ailleurs j’avais beaucoup d’amies en classe, que j’étais assez gaie quand je quittais la maison. Si ce manque affectif, ce sentiment d’abandon n’ont pas été à l’origine de ma maladie, je pense qu’ils ont contribué à l’aggraver. Ce symptôme a d’ailleurs été le déclencheur de nombreuses crises. Lorsque j’étais jeune, j’avais du coup beaucoup de mal à m’endormir le soir. Ma mère, au lieu d’essayer de me parler, me donnait des somnifères pour adultes, ce qui n’était évidemment pas très indiqué.
Mon adolescence s’est plutôt bien passée, puisque j’ai pu me défaire de l’emprise de mes parents et profiter d’une grande liberté. Sans pour autant faire les 400 coups, je me suis bien amusée et ça a été une période lors de laquelle j’ai découvert la séduction. J’espère ne pas en avoir profité. En tout cas, je n’ai pas eu de reproche dans ce sens de la part de mes partenaires masculins en particulier.
C’est à l’âge de 23 ans que j’ai connu mon premier vrai sentiment amoureux, en même temps que ma première crise maniaque. J’étais très liée à une amie que je voyais très souvent. On s’écrivait, on se téléphonait, on partait en vacances, etc. Et puis, un jour, je me suis rapprochée de son frère qui par ailleurs me courtisait énormément. On est sorti ensemble et ce rapprochement affectif a créé entre nous trois une véritable tornade émotionnelle.
En fait, ma meilleure amie avait le sentiment que je lui avais volé son frère. Ce dernier ne voulait se fâcher ni avec sa sœur ni avec moi. De mon côté, je voulais simplement que l’on me fiche la paix et qu’on me laisse vivre cette relation amoureuse tranquillement. Tout cela peut paraître un peu enfantin, mais c’est bien ce qui a déclenché une première crise maniaque très forte; d’autant plus forte que personne n’a su la comprendre: ni mes parents, ni mes amis, ni mon compagnon et encore moins le médecin chez qui mes parents avaient réussi tant bien que mal à m’envoyer. Il se passait quelque chose de grave, je le sentais. Ces états d’exaltation me faisaient tellement souffrir, que j’ai finalement moi-même demandé à être hospitalisée.
Je ne savais pas si cet état avait été provoqué par cette tornade émotionnelle à trois ou par un sentiment amoureux qui, je le sentais, allait durer. Cet homme est d’ailleurs devenu mon mari. L’hospitalisation a duré trois semaines et demie et a été suivie d’une dépression sévère. À l’époque, les troubles bipolaires étaient peu connus et je n’ai pas pu mettre de nom sur ce qui m’était arrivé. Plus tard, j’allais connaître sept autres crises, suivies de sept autres hospitalisations et de sept autres dépressions sévères.
Hélène Gabert : Entre mon adolescence et mon entrée en vie de couple, il s’est écoulé quinze ans de relations et de séparations, de rencontres et de ruptures. En fait, j’étais en permanence en quête d’affection. J’ai été jusqu’à consulter non pas un sexothérapeute, mais un astrologue et un numérologue, afin que l’on me dise quand j’allais enfin rencontrer la bonne personne.
À l’époque, j’étais cadre commercial, ce qui m’amenait à rencontrer de très nombreuses personnes et de nouer bien des relations, d’autant plus que j’étais quelqu’un de très sociable. À un moment donné, j’ai été déçue par toutes ces relations affectives. J’avais le sentiment que ma demande d’affection n’était pas suffisamment prise en compte, que l’on me considérait comme un objet sexuel. Je me suis alors dit que j’allais rendre la monnaie à mes partenaires et les traiter comme ils le faisaient. Je suis donc rentrée dans un monde de plaisir, dans des relations multiples et variées, au dépens du respect et de la protection de ma personne. Ma vie était calquée sur mes humeurs.
Pendant les trois ans qui ont précédé le diagnostic, les crises maniaques et les épisodes s’étaient intensifiés. J’étais traitée à coup de somnifères, anxiolytiques et antidépresseurs. Là déjà, d’un point de vue purement physique et sexuel, les choses changeaient. Lorsque j’étais en pleine forme, je mincissais, j’étais pleine de confiance en moi et la relation s’installait très vite. Ma libido était exacerbée. Et puis, le coup d’après, c’était la dépression. Je grossissais, j’avais une image de moi-même totalement dégradée, une estime de moi proche de zéro et une libido qui baissait très nettement sous l’effet aussi des médicaments. Tout cela venait faire barrage à la relation, jusqu’à ce que la vie de couple devienne quasi ingérable. Entre «tout bien» ou «tout mal», ça oscillait tout le temps.
Après plusieurs années de ce rythme, j’ai commencé tout à la fois à me fatiguer et à me poser des questions. J’aspirais à plus de constance, de pérennité, et souhaitais construire quelque chose. Après une énième rupture, la psychiatre qui me suivait a posé le diagnostic du trouble bipolaire. Le ciel m’est alors tombé sur la tête! À aucun moment je n’aurai imaginé que ces changements d’humeur puissent être causés par une maladie. Cela fut tout à la fois un soulagement et un choc. Comme on me l’a expliqué alors, ce trouble ne se soignait pas. Non traités ou pris en charge, les changements d’humeur risquaient avec le temps de devenir de plus en plus rapides, sans forcément avoir forcément besoin de causes exogènes pour se manifester. Il allait falloir que j’apprenne à vivre avec ces troubles, que je gère tout ce qui relevait des traitements et de la psychothérapie.
Quelques semaines plus tard, j’ai rencontré un homme qui m’a proposé de boire un café. «Un décaféiné allongé», ai-je dit. «T’es déjà pas compliquée toi, comme fille!» a été sa première phrase. «Non, je ne suis pas très simple», lui ai-je répondu. Lorsqu’il m’a déclaré sa flamme, j’étais encore sous l’effet de l’annonce du diagnostic et il ne fallait pas me parler de relations ni de quoi que ce soit. Je lui ai sorti de but en blanc: «De toute manière, on vient de me diagnostiquer un trouble bipolaire, donc si tu as envie de moi, tu prends tout ou tu ne prends rien!» Et là, il a dit «Banco! Moi je prends tout!» J’ai eu de la chance: cet homme-là est devenu mon mari. Nous avons très vite fait des projets. Au bout de six mois, on achetait une maison, après un an, on était marié et deux ans après naissait notre premier enfant.
Vie de couple
Marie Alvéry : Cela fait 22 ans que je vis avec mon mari. Nous avons eu deux enfants. Contrairement à Hélène, lui n’a pas su dès le départ que j’étais atteinte d’un trouble bipolaire. Mille fois, il aurait pu s’en aller, tellement je lui en ai fait voir! Non seulement il y avait mes changements d’humeur, mais aussi des crises maniaques qui me faisaient parfois perdre tout repère. Je me rappelle qu’à une occasion, au cours d’une grosse crise, je m’étais imaginé que le piolet de montagne de mon mari, entreposé à la cave, allait lui servir à trucider toute la famille. Je me souviens avoir amené mes enfants chez les voisins afin de les protéger de ce danger imaginaire. De retour de son travail, mon mari avait dû parlementer avec ces voisins. Finalement, j’avais laissé mes enfants repartir à la maison avec lui. Mais moi, il était hors de question que je regagne le domicile. Il y a ainsi eu de nombreuses crises, beaucoup de cris et de larmes. À plusieurs reprises, mon mari a été entraîné malgré lui dans mes délires, dans mes histoires.
Dans de telles conditions, la vie de couple est un art assez périlleux. La maladie nous un peu abîmés et, parfois, je me demande comment mon mari a tenu le coup, pourquoi il a choisi de rester. Par amour? C’est un mot qui veut tout dire et ne rien dire à la fois. Je pense que les raisons sont multiples. Peut-être est-il parti du principe que les crises maniaques duraient trois semaines au maximum, les hospitalisations trois-quatre semaines et qu’ensuite tout reprenait son cours habituel, comme si de rien n’était.
Quelque part, c’est peut-être en faisant un petit déni de la réalité de la maladie qu’il a réussi à la supporter et à rester. Même si l’on est plutôt bien ensemble, tout n’est pas rose au quotidien. Parfois, j’ai l’impression qu’il ne comprend rien à mes dépressions, notamment lorsqu’il me demande de me lever le matin alors que j’en suis incapable, de ne pas faire de sieste alors que je ne rêve que de m’effondrer dans le canapé. En permanence, il m’a poussée et je crois que c’est aussi de cette manière qu’il a peut-être réussi à accepter une situation aussi démente.
Hélène Gabert : J’ai eu la chance d’être soignée par une psychiatre qui estimait que la prise en charge de la maladie devait être globale et impliquer l’entourage. Loin de se poser comme l’unique détentrice du pouvoir thérapeutique, elle considérait que nous étions tous sur un terrain d’égalité et que nous avions chacun notre rôle à jouer. Elle a donc aussitôt décidé de convoquer mon futur mari afin de lui expliquer en quoi consistait ma maladie, lui montrer le rôle d’allié qu’il pouvait jouer et son «devoir de surveillance et d’accompagnement».
Nous voulions fonder une famille et c’est naturellement que la question du traitement médical s’est posée. Il était hors de question d’envisager une grossesse sans médicaments qui garantissent la stabilité de mon humeur. Aujourd’hui, il est tout à fait possible, dans ce type de situation, d’utiliser des normothymiques. Mais, à l’époque, seul existait le lithium. Avec des risques, lors des cinq premiers mois de grossesse, d’incidences sur le développement du cœur du fœtus. À un moment donné, j’ai décidé de me lancer tout de même dans l’aventure, d’avoir foi en la vie. Il y a eu bien entendu beaucoup de stress jusqu’au cinquième mois, mais finalement tout s’est bien passé et un beau bébé est né.
Très vite, j’ai choisi d’avoir un deuxième enfant et suis tombée enceinte. Malheureusement, je n’ai pas échappé à la dépression postnatale consécutive à mon premier accouchement. Du coup, ma deuxième grossesse s’est faite non seulement sous lithium, mais aussi sous antidépresseurs. Cette période a été plus difficile pour moi. Lorsque mon enfant est né, la sage-femme a dit que tout allait bien, que le bébé avait par contre onze doigts. Pendant un moment, je me suis demandé si elle plaisantait… Effectivement, mon enfant avait bien six doigts à une main. Cela était quelque chose de très courant et on m’a vite rassurée. Depuis lors, ce doigt supplémentaire a été supprimé.
Je me suis donc retrouvé avec deux enfants en l’espace de douze mois. L’un ne dormait pas le jour, l’autre a mis un an à faire ses nuits. Mon mari était très souvent en déplacement professionnel et ne pouvait guère m’aider. Je me suis ainsi vite retrouvée en burn-out maternel. Cette période a été si difficile que j’ai décidé par la suite de me faire ligaturer les trompes. Une troisième grossesse aurait en effet été inenvisageable. Il n’a d’ailleurs pas été facile de trouver un médecin qui accepte de faire cette opération sur la femme de 34 ans que j’étais. Il a fallu que je bataille et que ma psychiatre intervienne pour que cette stérilisation puisse avoir lieu.
Avoir des enfants lorsque l’on souffre de troubles psychiques pose donc de nombreuses difficultés. On ne peut s’empêcher aussi d’avoir peur de lui transmettre cette maladie. Ce que vous ne souhaiteriez même pas à votre pire ennemi, on ne le souhaite en tout cas pas à son enfant. Ma psychiatre me disait que si jamais cela devait arriver, je serais la mieux placée et la mieux informée pour pouvoir gérer la maladie et l’accompagner. Aujourd’hui, mes enfants ont huit ans et neuf ans et j’avoue que je suis très attentive à eux tout en veillant à ne rien projeter sur eux. Je laisse la vie se faire.
C’est lorsque j’ai fait une nouvelle crise il y a cinq ans, alors que je changeais de traitement, que j’ai enfin repris mes esprits et acquis une stabilité d’humeur qui m’a permis de savourer les instants de bonheur avec mes enfants. Avant, j’étais tellement épuisée qu’il m’était difficile de profiter au maximum de leur présence.
Pour finir, je dirais que le fait d’avoir des enfants représente beaucoup de travail, de contraintes, de fatigue, ce qui peut devenir à la longue difficile à gérer lorsque l’on souffre de troubles psychiques. Mais, en même temps, heureusement qu’ils sont là, parce qu’ils viennent apporter de la vie. Parfois, ce sont eux qui vous tirent du lit. Ils ne vous donnent pas le choix et vous imposent de vous mobiliser, ce qui est aussi utile.
Vie familiale
Marie Alvéry : J’ai également eu deux enfants. Mais je n’ai pas connu les mêmes problèmes qu’Hélène lors de mes grossesses, puisque ma maladie n’avait pas encore été diagnostiquée et que je ne prenais aucun médicament. J’ai fait un avortement entre les deux, d’ailleurs assez tardif, à cause d’un virus qui avait endommagé le cerveau du fœtus. Cette période a été très douloureuse pour moi. Un peu plus tard, j’allais connaître une nouvelle une crise maniaque, très forte qui a coïncidé avec ma deuxième grossesse. C’est après cette deuxième naissance que j’ai commencé à prendre des médicaments.
Par la suite, alors que je désirais avoir un troisième enfant, j’ai été très mal conseillée par un psychiatre qui estimait que les hormones de grossesse compenseraient le lithium que je prenais. Mais, sans médicament, je me suis très vite retrouvée à l’hôpital. Finalement, je n’ai pas eu de troisième bébé.
Mes enfants ont aujourd’hui 18 et 21 ans. On ne parle pas du tout de la maladie à la maison. Alors heureusement, pour eux, quelque part, qu’il y a eu l’écriture de ce livre, qui leur raconte un peu de leur histoire et leur remémore certaines choses. Ma fille a pu visiter et revisiter certains événements de sa vie. Quant à mon fils, il m’a rendu le livre. Probablement l’a-t-il lu, mais ne souhaite pas le dire. Il y a de sa part un énorme déni autour de la question de ma maladie. D’autant plus grand peut-être que lui-même ne va pas très bien en ce moment et qu’il fuit probablement les questions que lui pose ce livre. Cette situation me cause bien du souci.
On sait en effet que les troubles bipolaires peuvent se transmettre aux enfants; parfois, il peut aussi s’agir d’autres types de maladie psychique. Lorsque quelque chose ne tourne pas rond chez un de nos enfants, on ne peut s’empêcher de se poser des questions. J’essaie malgré tout de faire confiance. Et de me dire aussi que l’adolescence n’est peut-être pas la période de vie la plus propice pour dialoguer avec eux autour de ce thème-là.
Hélène Gabert : Mes enfants, du haut de leurs huit-neuf ans, me posent déjà beaucoup de questions sur ma maladie. Lorsque je leur parle d’alternance entre haute et basse énergie, de médicaments, tout cela ne leur évoque encore pas grand» chose. «Prendre un médicament pour un trop-plein d’énergie, c’est nul! C’est bien l’énergie» me dit mon fils.
Quant à mon mari, il n’a pas lu le livre. Il n’estime pas nécessaire de lire ce qu’il a en grande partie déjà vécu. Lors de la sortie du livre, il m’a avoué qu’il était très enthousiaste à s’embarquer dans cette histoire avec moi, sauf qu’il ne savait pas combien de temps il allait être capable de supporter cela. Mais il est toujours là. Et aujourd’hui, en ayant changé de traitement, en ayant maintenant une vie quasiment normale, tout va pour le mieux pour nous, ou presque.